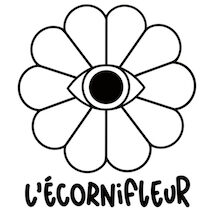« A 40 ans, j’ai réalisé que peu importe où j’irais dans le futur, j’avais déjà réalisé ce qui correspondait à mes attentes originelles d’une vie », écrit Oliver Stone dans son autobiographie, A la recherche de la lumière, parue le 7 octobre aux Editions de l’Observatoire. Aujourd’hui mondialement connu et quatre fois oscarisé, le réalisateur de 74 ans n’a plus besoin de faire ses preuves. Un parcours façon American dream pour celui qui a laissé au Vietnam ses illusions sur son pays, et qui raconte dans son livre, avec un style poétique et cru qui rappelle ses films, comment le cinéma l’a sauvé.
Du bonheur familial au traumatisme de la désunion
Au fil des pages, Oliver Stone revient sur la rencontre de ses parents et sur sa relation avec son père, financier, qui lui inspirera l’un de ses plus grands films, Wall Street. Mais aussi avec sa mère, qu’il décrit avec tendresse et admiration, elle qui ressemblait « à Scarlett O’Hara ». Une enfance heureuse pour le jeune Oliver, qui lui semblait pouvoir durer éternellement : « Dans mon esprit du moins, nous étions tous les trois unis et le monde était à l’extérieur. J’étais aimé par des parents qui s’aimaient clairement ». Une enfance qu’il raconte tel un film hollywoodien, où rien ne vient gâcher le bonheur, à l’exception de la fausse couche de sa mère qu’il vit avec horreur, le laissant définitivement fils unique.
Quinze ans plus tard, c’est une discussion avec son père qui va bouleverser sa vie, et lui apporter sa première désillusion : « Oliver, ta mère et moi allons divorcer ». Une révélation qui remet les croyances du jeune homme en question. Sans trop de conviction, il s’inscrit à l’université de Yale, mais Oliver peine à trouver sa voie. En 1965, il part donner des cours d’anglais à Saïgon, avant de repartir en voyage au Cambodge, en Thaïlande et au Laos. A son retour, en 1966, il tente de réintégrer Yale « mais le cœur n’y était pas ». Alors, comme tant d’autres américains, Oliver fait un choix : celui de s’engager dans la guerre du Vietnam.
Le Vietnam : une désillusion définitive
“J’étais pressé de rejoindre le front avant que cette guerre ne finisse, ce que les médias annonçaient pour bientôt. Je voulais être comme tous les autres, un fantassin anonyme, de la chair à canon, dans la boue avec les masses dont parlait John Dos Pasos. »
Engagé volontaire à 21 ans, le Vietnam est pour Oliver Stone une expérience fondamentale, dans sa vie comme pour sa future carrière de cinéaste : le conflit est au cœur de trois de ses plus grands films, Platoon, Né un 4 juillet et Entre ciel et Terre. L’horreur perçue par les yeux du jeune Stone détermine le ton cru, violent et politiquement virulent de sa future filmographie.
Les épisodes racontés dans Chasing the Light n’épargnent pas les soldats américains, parmi lesquels le réalisateur s’inclut. « C’était une sorte de jeu, si on pouvait les foutre en l’air sans se faire choper ; certains gars étaient comme des vilains enfants avec des fusils qui arrivaient à ne pas se faire punir. » Dans le récit de son premier meurtre, Stone compare la folie qui l’a saisi à celle du héros de l’Etranger : « peut-être que, comme Camus l’a un jour décrit, j’avais juste une migraine et le soleil brulait trop fort dans mes yeux. ».
Cette expérience marque la désillusion définitive d’Oliver Stone à l’égard de son pays. Une bascule qui rappelle le destin de Ron Covic, dont l’autobiographie a inspiré Né un 4 juillet, deuxième opus de la trilogie de Stone sur le Vietnam et satire virulente des Etats-Unis.

Retour au pays et début du cinéma : enfer et salvation
Comme tant d’autres, Oliver Stone revient de la guerre perdu, déchiré, vidé. Commence une période d’errance, pendant laquelle il s’enfonce dans ses démons du Vietnam : ceux de la drogue et de l’alcool. Un jour, loin des prises du réel, il se fait arrêter par la police en possession de drogue : « En moins d’une heure, j’ai été menotté à une chaise, interrogé par deux agents du FBI. […] Pas d’argent, pas de caution, rien. J’ai été conduit dans une salle d’audience où j’ai été inculpé de contrebande fédérale, passible de cinq à vingt ans de prison. » Un épisode qui ne manque pas de rappeler Midnight Express, dont il signe le scénario, où William, jeune homme candide, est emprisonné trente ans en Turquie pour possession de drogue.
Un an après son retour du Vietnam, il s’inscrit à la NYU’s School of the Arts, « pas vraiment dans un but précis, mais parce qu’il y avait peut-être quelque chose à faire“. Il y reste jusqu’en 1971, mais Oliver Stone n’est pas dupe : « Aucun travail ne nous attendait et ce qu’on faisait n’intéressait pas. Un diplôme de BFA en cinéma ne signifiait rien d’autre qu’un autre certificat sur le mur [..]. Je n’avais pas d’illusions“.
Pourtant, le réalisateur en devenir ne lâche rien, et commence l’écriture de quelques films, de séries B. Puis, c’est en 1986 qu’Oliver Stone apparaît sous le feu des projecteurs, avec la sortie de Salvador, chronique de la dictature militaire, son premier vrai succès en tant que réalisateur.
Platoon : succès, exutoire et apaisement
« Alex Hoe, le chef de production chinois […], vient me voir et me dit, non sans ironie: “Félicitations; Ollie, ça a été deux longues années.” “Non, vingt longues années” ». Dès le retour d’Oliver Stone du Vietnam, Platoon semble en gestation. Le réalisateur consacre plusieurs chapitres de son livre à la recherche difficile de budget pour la réalisation de ce film.
Quand le il parvient enfin à réaliser, avec un budget modeste, ce qui est pour lui le film le plus important de sa vie, celui-ci rencontre un succès inattendu. Le livre s’achève sur sa consécration aux Oscars, où il reçoit, entre autre, le prix du meilleur film. Une récompense qui, comme le dit Oliver Stone dans son discours de remerciement, montre que « pour la première fois, vous comprenez ce qui s’est vraiment passé là-bas, et que ça ne devrait plus jamais arriver dans nos vies. »
Sa volonté de rétablir la vérité traverse cette autobiographie, ainsi que sa haine pour le mensonge, pour lui inhérent aux Etats-Unis : « Le mensonge dans notre culture était à la racine de notre échec. C’est peut-être notre amour pour l’exagération. Dans nos reportages de combats, dans nos films, nous rendions tout plus gros qu’en réalité – jusqu’à compter les civils comme des soldats dans les chiffres des cadavres ».
A l’opposé, sa conception du cinéma est liée à la vérité, se rapprochant en cela du journalisme : en témoignent ses immersions dans les milieux de la drogue à Miami avec Scarface, dans le milieu de la bourse pour Wall Street ou encore son intérêt pour les lanceurs d’alerte avec Snowden.