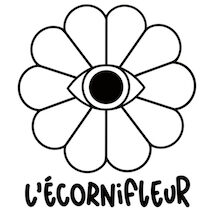Multi-récompensé pour ses photographies de la guerre syrienne, le photojournaliste Ameer Alhalbi Mashhadi a été victime, en 2020, de coups de matraques de policiers alors qu’il couvrait une manifestation en France. Une expérience qui a réveillé des souvenirs traumatisants d’Alep et n’a fait que renforcer sa détermination à défendre le droit d’informer. Portrait.

Quand l’une de ses photographies reçoit le prix « Photographe de l’année » du magazine Polka en 2016, il n’apprend la nouvelle qu’une dizaine de jours plus tard. Couvrant le conflit syrien dans sa ville natale d’Alep, alors assiégée, se connecter à Internet pour vérifier ses mails était très compliqué. Sous le nom d’Ameer Al Halbi, il s’est vu décerner la récompense… le nom qu’il avait choisi pour se protéger de la répression du régime de Bachar al Assad.
Dans cette ville battue sous le coup des bombardements russes et syriens, il s’était fixé comme défi de capturer la souffrance des parents cherchant à sortir leurs enfants des ruines. Lui, a vécu l’inverse : Son père, secouriste et membre des « Casques Blancs », seule organisation humanitaire alors opérationnelle, est mort sous ses yeux dans une frappe aérienne russe. Dernier souvenir de son père ? Il portait secours à des civils visés par une autre frappe, s’étant produite quelques minutes plutôt, au même endroit. Ameer avait 20 ans.

« Comment célébrer la reconnaissance d’une photo de guerre ? »
Sur le moment, au milieu du chaos, la joie est fugace. « Dans un environnement de deuil ambiant, il est impossible de célébrer la reconnaissance d’une image qui raconte l’apocalypse d’un pays. » Le retour à la réalité ne tarde pas lorsqu’un départ de la ville s’impose. Ameer fera partie des 400 000 personnes forcées d’évacuer par un accord négocié entre la Russie et la Turquie fin 2016. Le retour du régime de Bachar Al Assad dans la ville suscite alors l’indignation mondiale : un tournant mettant un terme au rêve démocratique.
Six ans plus tard, il est sur le canapé de son appartement du XIIIème arrondissement de Paris et boit son « café sada » [en arabe, sans sucre] du matin. Sur le mur au-dessus de lui, sont accrochés les autres prix qu’il a gagnés ces dernières années. Ses photographies du conflit syrien, devenues symboliques d’une guerre menée depuis 2011 par un dictateur contre son peuple, ont fait le tour du monde.
Il a pourtant traversé des moments de doute. En Turquie, où il s’exile en 2017 avec sa mère et sa sœur cadette, l’heure est à la remise en question. Tout son travail a-t-il servi à quelque chose ? C’est au tour de World Press Photo de l’inviter aux Pays-Bas pour recevoir un prix dédié à sa série de photos « Rescued From the Rubble. » Là encore, l’enthousiasme est passager. Une crise diplomatique turco-néerlandaise éclate et l’empêche d’obtenir un visa lui permettant de se rendre sur place et de recevoir sa récompense. Il reçoit le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre et rejoint la France peu de temps après.

Blessé en couvrant la marche des libertés à Paris
Bien qu’il n’ait pas choisi l’exil, l’adaptation à la vie parisienne où « il y a des manifs tous les samedis » n’a pas été difficile. Ameer apprécie de pouvoir continuer à faire ce en quoi il excelle. Mais le 28 novembre 2020, il va vivre un cauchemar. Ce jour-là, il couvre la marche des libertés à Paris contre la proposition de loi pour une sécurité globale dont l’article 24, censuré depuis par le Conseil constitutionnel, prévoyait une peine de prison pour la diffusion malveillante d’images de policiers. Collé contre un mur avec tout un groupe de journalistes, il est pris pour cible par une charge menée par la police et reçoit, en plein visage, de violents coups de matraques.
Sans casque ou brassard ni carte de presse, le photojournaliste affirme pourtant avoir été identifiable car il criait avec ses confrères « presse, presse ! » Blessé, il raconte, un an et demi après l’événement, que « pendant environ 30 minutes, les gens me parlaient mais je n’entendais rien » Depuis, raconte-t-il : « beaucoup de flash-back s’entrechoquent dans ma mémoire. »
Les flash-back d’Alep
Ce flashback dont il parle se rapporte à un événement s’étant produit en 2012. Ameer, talentueux joueur de foot, est âgé de 15 ans. Alors qu’il participe à une manifestation anti-régime à Alep, il reçoit deux balles dans la main. Quand il est transféré à la prison au lieu de l’hôpital, il est persuadé que c’est la fin pour lui. Il y passe un mois. Lors de ses quelques transferts à l’hôpital, menotté, il se sent comme un criminel.
Huit ans plus tard à Paris, Ameer est pris en charge par le personnel soignant. Aucune anesthésie n’est envisageable, l’endroit touché – près de son œil gauche – étant très sensible. Il comprend vite qu’au-delà de lui, c’est le droit d’informer qui est en jeu.
En 2021, Reporters Sans Frontières (RSF) a classé la France à la 34ème place sur 180 pays en matière de liberté de la presse. Ameer découvre que dans le pays de la liberté et des droits de l’homme, les journalistes couvrant les manifestations courent le risque d’être touchés par des tirs de lanceurs de balles de défense (LBD), de grenades lacrymogènes ou par des coups de matraques. « Aucun photojournaliste ne souhaite voir son image, visage ensanglanté, à la télé » dit-il en indiquant avoir été très sollicité par les médias, français et internationaux, dès le lendemain de l’incident.
Les journalistes sont parfois la « cible d’interpellations arbitraires à l’issue desquelles leur matériel est saisi », peut-t-on lire sur le site de l’ONG RSF. Les exemples sont nombreux. Quelques jours avant lui, trois journalistes ont été brutalisés, le 23 novembre 2020, alors qu’ils couvraient une opération policière visant à démanteler les tentes des demandeurs d’asile installés à la place de la République. Comme eux, Ameer décide de porter plainte, seul et avec RSF. Si ces enquêtes judiciaires sont toujours en cours, une vidéo réalisée par les journalistes de Le Monde a permis d’identifier le policier qui l’a matraqué et de transmettre l’information aux services compétents.
Ce malaise « palpable dans la ville de la liberté » entre journalistes et policiers a choqué Ameer. Pourtant, il n’est pas question pour lui que son rapport à la France se résume à cet incident. « Je suis face à deux choix : la morosité ou l’adaptation pour vivre avec. Je choisis le deuxième. »
Mahmoud Naffakh