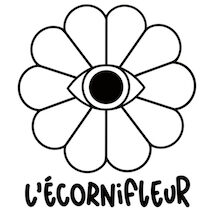Lundi, le Parlement a adopté la Loi d’Urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Celle-ci crée un nouveau régime juridique exceptionnel, l’état d’urgence sanitaire, permettant au ministre de la santé de prendre des mesures exceptionnelles pour lutter contre une crise sanitaire. Analyse avec Karine Roudier, professeure de droit constitutionnel et spécialiste des régimes dérogatoires au droit commun.
Report du second tour des élections municipales, création de l’état d’urgence sanitaire, dérogations nombreuses aux Code du Travail, possibilités pour le gouvernement de légiférer par ordonnances sur de nombreux sujets, absence, dans le texte, de contrôle direct du Parlement … La loi d’urgence pour lutter contre le Coronavirus adoptée lundi 23 mars fait débat et interroge sur l’existence de garde-fous pouvant contrôler l’action du gouvernement en temps de crise. Décryptage avec Karine Roudier, professeure à Sciences Po Lyon en droit constitutionnel.
Théo Uhart : Le déclenchement de l’Article 16 de la Constitution, relatif à l’attribution des pleins pouvoirs pour le président de la République a été évoquée dans la presse mais pas retenue par Emmanuel Macron. À juste titre selon vous ?
Karine Roudier : Oui, c’est une bonne décision. Lorsqu’on prend la rédaction de l’article, on voit bien que les conditions sont cumulatives. L’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels n’est aujourd’hui pas remplie, puisque le Parlement s’est réuni et a pu discuter et adopter la loi sur l’état d’urgence sanitaire.
T.U. : Le gouvernement a préféré dégainer un texte d’urgence qui instaure dans le droit un état de crise sanitaire. Les dispositifs qui existaient jusqu’alors, comme l’État d’urgence, ne suffisaient pas ? Pourquoi ?
K.R. : Il y a deux choses. La première question : pourquoi pas la loi du 3 avril 1955 sur l’État d’urgence, comme elle a été révisée, modifiée et mise à jour depuis 2015 ? Elle aurait pu subir une nouvelle modification pour faire face à cette catastrophe sanitaire. Un ensemble d’articles de cette loi permettent ou au Ministre de l’Intérieur ou au préfet de restreindre les libertés individuelles. Il aurait fallu insérer la possibilité pour le Ministre de la Santé.
Toutefois, on peut imaginer que le gouvernement a renoncé car la loi de 1955 est très large. Il aurait fallu procéder à sa modification et demander qu’un certain nombre d’articles ne rentrent pas en vigueur, notamment celui relatif aux perquisitions administratives ou celui sur la dissolution des associations ou groupements (art. 6-1).
La deuxième chose, c’est que, symboliquement, l’État d’urgence est très associé à la lutte contre le terrorisme. Je pense que c’est plutôt sur cette deuxième raison que s’est jouée la décision de l’exécutif. Quitte à ce que se réunisse le Parlement, autant créer un nouveau dispositif, adapté à la situation. D’autant que l’on risque malheureusement de vivre d’autres crises de ce type.
T.U. : De nombreux sujets sont abordés dans la loi d’urgence adoptée par le Parlement promulguée mardi 24 mars. Entre autres, des mesures pour restreindre les libertés individuelles. Les contre-pouvoirs sont-ils suffisants ?
K.R. : On est comme sur la loi de 1955, face à un surcroît de pouvoirs donné à l’exécutif. Dans cette transmission des pouvoirs, il y a un risque d’arbitraire. Il est justifié parce qu’il faut mettre fin à la crise sanitaire que nous traversons et il est contrebalancé parce qu’il y a des contre-pouvoirs, parlementaires et juridiques. Il faut espérer qu’ils jouent pleinement leur rôle.
L’exécutif a fait en sorte de se libérer au maximum des contraintes possibles. Dans le Titre IV de la loi (relatif au contrôle par le Parlement), un second article précisant, comme dans le cadre de l’état d’urgence, que les assemblées recevront copie de tous les actes pris en application de la cette loi aurait été bienvenu. On peut vraiment regretter que le gouvernement n’ait pas voulu faire apparaître cela.
T.U. : Ce texte donne à l’exécutif la possibilité de légiférer par ordonnance sur un panel de sujets assez large. Est-ce que c’est trop ?
K.R. : Le gouvernement fait en sorte d’avoir la latitude la plus grande pour tout affronter. Il y a à la fois la priorité – tout ce qui est du domaine de la santé – et un “effet domino” avec des effets plus ou moins rapides. Tous les secteurs étatiques vont être touchés. À travers ce surcroît de pouvoir, le gouvernement s’octroie la possibilité de gérer toutes les éventualités.
Là où il faut espérer que les choses se rétablissent, c’est lorsque les ordonnances seront soumises à la ratification des chambres, dans un délai de deux mois [en attendant, l’ordonnance est en vigueur. Si ratifiée, elle devient une loi, ndlr]. Là, le parlement a tout son rôle à jouer pour contrôler l’action du gouvernement.
T.U. : Le texte déroge également à un grand nombre de dispositions du Code du Travail. Et ce sans date butoir d’application. Est-ce normal ?
K.R. : On peut toujours voir quelque chose de caché dans l’ensemble des dispositions. Lorsque l’on regarde l’ensemble de l’article 11, il faut noter que, dans tous les cas, les ordonnances doivent dans un délai de deux mois être soumises à ratification devant le Parlement. Cela contraint déjà par rapport à leur application. Ensuite, cet état d’urgence sanitaire est déclaré pour deux mois, et ne pourra être prolongé que par une loi. Ce qui veut dire que l’ensemble des pouvoirs du gouvernement vont très vite arriver à une date butoir.
J’ai aussi une forme d’espoir dans la vivacité des contre-pouvoirs dans notre pays. Les ordonnances pourront être contestées devant le juge administratif. De plus, l’article 38 de la Constitution est très clair sur la procédure. Une ordonnance est discutée en Conseil des Ministres et commence à avoir des effets juridiques dès qu’elle est publiée. Si le projet de loi de ratification n’est pas déposé au Parlement ou si celui-ci rejette la ratification, les ordonnances sont caduques à la fin de ce délai. Si le Parlement ratifie les ordonnances en revanche, elles continuent de s’appliquer et deviennent des lois.
T.U. : Donc, si le Parlement ratifie les ordonnances, on pourrait être face à une modification pérenne du Code du Travail ?
K.R. : C’est un risque. Ce sera le rôle du Parlement de s’assurer que les ordonnances n’amènent pas de réformes profondes. C’est en tout cas mon espoir. On est dans une situation où nous sommes tous directement concernés. On peut espérer que nous n’aurons pas la mémoire courte et que dans deux mois, nous serons toutes et tous attentifs à ce qui sera présenté au Parlement.
T.U. : La loi entérine les résultats du premier tour des élections municipales et repousse a posteriori le second tour, à condition que celui-ci ait lieu avant le mois de juin. Que penser de cette solution ?
K.R. : On est dans une situation inédite. Le gouvernement crée une situation juridique et des actes sans précédent. Une crise d’une telle ampleur ne s’était jamais produite dans un cadre d’élections. Aujourd’hui, la solution choisie par le gouvernement est sans doute celle qui faisait le plus consensus au niveau des partis politiques. Si ce n’était pas le cas au premier tour – et c’est d’ailleurs sûrement pour ça qu’il s’est tenu – il y a une forme de cohésion nationale désormais autour du report du second tour, dans un délai qui semble raisonnable. Cela permet aux équipes déjà en place de continuer à gérer une crise qu’elles avaient déjà commencé à gérer, évitant ainsi un changement d’équipe en pleine crise.
T.U. : La Constitution ne dit rien sur la régularité des résultats dans des cas de faible participation. Néanmoins, si un recours est porté devant le juge administratif, qui est le juge des élections municipales, peut-on imaginer que des résultats soient annulés ?
K.R. : Non, il n’y a effectivement pas de seuil minimal de participation pour la validité d’une élection. On pourrait avoir des recours mais il faudrait que ceux-ci démontrent qu’il y a tant de personnes qui ne sont pas allées voter car elles avaient peur de l’épidémie, et que ces personnes auraient voté pour telle liste, ce qui aurait permis à cette liste X de dépasser la liste Y. Si des recours prospèrent sur ce fondement, il faut vraiment que celui qui engage le recours fasse valoir des arguments de poids et très concrets.
T.U. : Si un tiers des élus d’un conseil municipal démissionne, il faut refaire une élection. Est-ce une possibilité à laquelle le gouvernement pourrait appeler dans les communes où la participation a été très faible ?
K.R. : Ce serait antinomique par rapport à la loi adoptée. Soit c’est une opposition qui essaie de promouvoir cette position-là, soit si le gouvernement voulait l’envisager autrement, il l’aurait fait dans la loi. Et cela aurait fait hurler. Cela aurait été une forme d’atteinte à la vie démocratique.
Cette solution est potentiellement envisageable, au niveau local, si des élus décident d’eux-mêmes qu’ils souhaitent avoir une base plus large au sein de la population et recherchent ainsi plus de légitimité.
Propos recueillis par Théo Uhart