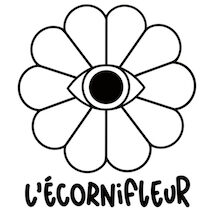Mardi 17 mars, midi. Début du confinement, la France tourne au ralenti. A travers le récit de trois journalistes de l’Ecornifleur, revivez jour après jour la semaine du 15 au 22 mars, celle durant laquelle le pays a basculé, avec la progression de l’épidémie de coronavirus, dans une crise sanitaire inédite depuis un siècle. Pour ce premier épisode, Gauthier prend la parole pour nous raconter son point de vue sur la situation.
Début mars encore, le confinement de Wuhan était pour nous inenvisageable en Europe. 17 mars 2020, Saône © Gauthier Mesnier
Samedi 14 mars, la France passait au stade 3 de l’épidémie de Covid-19. Récit d’une jeunesse de France qui peine à prendre réellement conscience de l’ampleur des conséquences à venir sur la vie du pays.
Lundi 16 mars. 14 rue Mégevand, Besançon, 19h30. L’ombre fraîche de Mars a déjà absorbé cheminées, clochers, mairie. A l’angle de la rue déserte de l’Orme de Chamars clignote le « Tabac, Presse, Loto », un des huit bureaux de tabac que compte encore le centre-ville. Capuche noire sur la tête, un trentenaire sort furtivement de l’établissement, un pot de 250 grammes de tabac sous le bras. Sept coups de cloches, le bruit des néons couvrent difficilement l’épais silence qui vient de s’abattre sur la ville. Paquet de spaghettis n°5 et pot de sauce dans la poche intérieure de mon manteau, Ryan, un ami, ironise au milieu de la rue : « Ils attendent les allemands ou quoi les gens ! ». Mathilda, ma copine, lui tape l’épaule en riant. La veille, on quittait Lyon après une soirée trop alcoolisée, prolongation malvenue d’une jeunesse incapable encore de prendre conscience que leur vie étudiante allait marquer un net coup d’arrêt.
Sur le téléviseur Panasonic de la mère de Mathilda, yeux de loup et mâchoire stricte, le Président assène : « Jusqu’alors, l’épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d’entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante (…) Nous sommes en guerre (…) sommes en guerre, (…) en guerre… ».
Hélène, la mère de Mathilda, est fatiguée. Ses yeux sont tournés vers la télé mais un voile se forme, son regard se perd derrière les épaules de Macron, dans le décor doré de son bureau élyséen.
Le lendemain, rendez-vous à 9h aux Pompes Funèbres pour la mise en bière de Nicole, la mère d’Hélène, décédée le 11 mars à 82 ans, après avoir été testée négatif au coronavirus.
Verre de Chablis à la main, Hélène, décroche son téléphone. Le temps se suspend, Hélène baisse la tête, passe la main dans ses cheveux. « Elle va partir toute seule », répète-elle à voix basse. Pour des questions sanitaires, la cérémonie de sa mère n’aura pas lieu, personne ne rentrera au crématorium. Nous prenons conscience avec Mathilda qu’il va sérieusement falloir trouver un lieu de confinement.
Wikipédia m’informe : « le virus « appartient au sous-genre Sarbecovirus . Son génome, stable et constitué d’un ARN simple-brin de 29 903 nucléotides, a été séquencé pour la première fois le 5 janvier par une équipe de l’Université Fudan de Shanghai (Chine). »
Mardi 17 mars. 10h00. Une vingtaine de personnes se tient autour du cercueil de Nicole sur le parking des pompes funèbres, au milieu de la zone commerciale froide et venteuse de l’ouest bisontin. A gauche, Kiabi a fermé ses portes. A droite, Leroy Merlin continue d’accueillir encore quelques clients. Sur la devanture on peut lire en rouge : « FULL CAISSE AUTOMATIQUE ». L’autoradio du corbillard crache péniblement « La Vie en Rose » d’Edith Piaf. Quelques discours étouffés ponctuent la cérémonie. Hélène, d’une santé fragile, n’approche personne, étrange deuil dénué de contact humain. Puis le corbillard emporte le cercueil, l’imposant vaisseau noir se dirige vers le crématorium, dernier voyage avant un départ anonyme.
Il est midi. Il ne reste plus que le premier cercle familial. J’en profite pour téléphoner à mes parents. Pierre-Luc, mon père, est médecin généraliste dans une commune de 2000 habitants à l’ouest de Besançon. Issu d’une famille de droite catholique, l’angoisse est inscrite dans son patrimoine génétique. Après l’élection de François Mitterrand, son père avait cloué la porte de sa maison avec des planches par peur de l’expropriation des « rouges du gouvernement Mauroy ».
Depuis le confinement de la ville de Wuhan, mon père anticipe, prend ses précautions en consultation. La peur est parfois bonne conseillère. Ma mère quant à elle s’occupe de ma grand-mère, veuve depuis six mois et diminuée par une opération de la hanche. Mon père préfère ne pas nous accueillir. Ma mère accuse le coup : « Pour moi c’est la triple peine. Mes fils vont me manquer, je m’occupe de ma mère et mon mari fait chambre à part. »
En raccrochant, je mesure l’étendue des victimes collatérales de la crise à venir. Ca va faire mal, l’isolement des anciens, la détresse des mineurs isolés, des réfugiés, des diabétiques. Ca va faire mal le confinement dans l’insalubrité et la promiscuité, dans un pays où 400.000 mal-logements sont déjà la cause de 500 décès par an. Ca va faire mal, le service public hospitalier fragilisé depuis tant d’années par d’inlassables coupes budgétaires. Ca va faire mal les déserts médicaux, l’absence de dialogue dans les entreprises, surtout les grandes, qui ne lâcheront rien sur les dividendes et la préservation du capital. Je le sens : comme à chaque crise, les précaires paieront l’addition et régleront les ardoises du système économique qu’ils n’ont pas voulu.
Mathilda appelle Phillipe, son père. Il propose de nous accueillir dans sa vieille ferme rénovée à Saône, sur la route de Lausanne. Il y aura aussi Laurence, sa compagne et Pauline, sa fille.
Chacun se salue, se disperse dans les voitures. Dans la Fiat 500 d’Hélène, Nagui présente La Bande Originale. Un nouveau décompte tombe : 7730 cas confirmés, 175 morts. On les rangera rapidement dans des boîtes. Juste le temps peut-être, d’avoir aperçu à travers la vitre du CHU quelques arbres en fleur, le début d’un printemps qu’ils ne verront jamais.
Mercredi 18 mars. La Grange St Ferjeux, 9h. Ouverture des volets, soleil éclatant, 13°C au mercure. L’horizon est clair, l’herbe verte, les cloches couvrent doucement l’aspirateur qui s’active au rez-de-chaussée.

L’agriculture continue malgré les risques. Tous les soirs, Benjamin, 13 ans, ramène un cheptel de 110 vaches à l’étable de son père. Saône, 19 mars 2020 © Gauthier Mesnier
Le monde d’hier semble loin, le monde des morts, des « cas recensés », de BFMTV et ses bandeaux déroulants, du « chaos Gare du Nord », du parking des pompes funèbres.
Pourtant, par ses canaux médiatiques, le monde d’hier nous rattrape. A midi, Europe 1 dénombre 8900 cas et 220 décès. 45 décès supplémentaires en même pas 12 heures. Les cercueils alignés dans l’Eglise de Bergame saturent les réseaux sociaux. Notre bucolique bulle d’herbe fraîche me paraît soudainement indécente.
« Restez chez vous », nous supplie au JT de 13h de France 2 un interne alsacien du CHU de Strasbourg. Déjà, en Alsace, les personnels hospitaliers manquent de masques, de gels, de gants, de respirateurs, de lits.
Jeudi 19 mars. 11.000 cas recensés, 372 décès. Geneviève Chêne, directrice générale de l’agence sanitaire Santé Publique France prévient sur France Info TV : « S’il est trop tôt aujourd’hui pour pouvoir affirmer quoique ce soit sur la dynamique de l’épidémie en France, l’exemple chinois indique que l’inversion de la courbe interviendrait autour de mi-mai ».
L’assemblé se met à table. A force de savon, les mains sont calleuses et sèches. Mathilda s’inquiète pour sa sœur Juliette, intérimaire chez Ricupero, une PME produisant des pièces composite en acier. Franck Ricupero, fils d’immigré italien, contremaître devenu patron de l’entreprise de 65 salariés, refuse d’arrêter ses chaînes de production. Il a des commandes à honorer. Phillipe défend Franck, son ami du golf : « le gouvernement n’oblige pas à arrêter, ils n’arrêtent pas c’est normal. » Les esprits s’échauffent, le ton monte. Il me semble bien naïf de penser que le patronat cessera ses activités sans une interdiction venue d’en haut ou sans une utilisation massive du droit de retrait. D’ailleurs, Ricupero est expert en tôlerie fine, l’entreprise n’a pas de représentants syndicaux. Par message, Mathilda demande à Juliette si elle compte rompre son contrat d’intérim. Juliette lui répond : « J’ai écouté aux portes…Franck pense que la moitié de la population va être touchée, que les faibles allaient mourir et les forts allaient survivre. » Le darwinisme économique et social n’a pas quitté le cerveau étriqué du patronat. Hier comme aujourd’hui, il est et sera prêt à sacrifier les masses laborieuses pour s’assurer la conservation de ses marges.
Vendredi 20 mars. 10h. Un rayon de soleil traverse la vitre du salon. Le faisceau fait danser la poussière en suspension. Dehors, les vaches ruminent, imperturbables. Il fait déjà chaud. Mon téléphone sonne : c’est Fred, mon collègue à l’Agence d’urbanisme de Lyon.
Voilà une semaine, je quittais mon poste d’enquêteur téléphonique à l’agence, pensant le retrouver le lundi suivant. Fred m’indique que les services de l’agence ont enfin pu mettre en place le logiciel de télé-travail : cet après-midi, je reprends l’étude sur les loyers que nous menons auprès des locataires du Grand Lyon : « Bonjour Gauthier Mesnier de l’Agence d’urbanisme de Lyon (…) pouvez vous me communiquer le montant de votre loyer hors charges s’il vous plait ?… ». Derrière, le bruit des enfants qui crient et une voix de jeune père de famille déjà fatigué : « Ma femme est au travail, je vis dans un appartement de 60 m² avec 3 enfants de 3, 7 et 10 ans, je suis désolé Monsieur mais je n’ai pas la tête à ça ». Coupable, je tente un « bon courage », la ligne se coupe.
L’ampleur d’une crise révèle la vacuité des gens et des choses. Sur LCI, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail dénonce « le manque de civisme » des entreprises du BTP qui souhaitent stopper les chantiers. L’enjeu est de taille : le BTP représente 2 millions d’emplois, 10% des actifs français. Autant de chômeurs partiels pour le gouvernement. Elle les accuse de « défaitisme ». Un terme historiquement lourd de sens, réservé tantôt au gouvernement vichyste de mai 1940 tantôt aux communistes « séditieux » soutenant Staline en 1939.
Samedi 21 mars. 18h00. Le vent fait claquer les volets et s’infiltre dans les moindres recoins de la vieille grange en pierre. Pauline et Laurence reviennent d’une balade à pied, échangent autour d’un thé sur la nappe cirée jaune de la cuisine.
Pauline n’a pas grandi avec sa mère. Lorsque cette dernière a quitté la famille, elle n’a pas obtenu la garde de sa fille unique. Samedi dernier, Pauline a senti le confinement inévitable, a choisi de ne pas mettre en danger son père, greffé il y a peu du poumon gauche. Au fil des repas qui ponctuent les journées, la jeune femme de 28 ans scrute sa mère comme pour comprendre quelque chose, après toutes ces années. Mère et fille échangent pudiquement, tentent de tisser un lien nouveau. Elles parlent « bouffe », se remémorent les quelques plats que Laurence cuisinait lorsque Pauline était petite. « Tu te souviens Pauline, tu regardais Bon Appétit Bien Sûr avec Joël Robuchon ! » L’heure de l’apéritif arrivant, Laurence sort un plateau de Yam’s, une bouteille de vin du Jura et dispose des petits Bretzels durs au coin de la table.
Une mère et une fille retissent un lien abîmé par les années et l’armée s’active à la hâte pour déployer le premier hôpital de campagne à Mulhouse. Des lits de camps sont déjà alignés comme à la fin d’un mauvais film de guerre hollywoodien. Les images tournent en boucle sur les chaînes d’information en continu.
Dimanche 22 mars. Si la nature à horreur du vide, l’oisiveté fait horreur aux hommes. « Il va falloir s’occuper », nous lâche inlassablement Phillipe, le regard perdu par la fenêtre au moment du café d’après manger.
« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. », disait Pascal. Il faut s’occuper. Sur les réseaux sociaux, Konbini, Quotidien et consort multiplient les « playlists de confinement » ; diffusent les story des acteurs culturels du petit Paris. « Pygama, Netflix, canapé » pour les femmes, « Tuto muscu » pour les hommes. Même confinés, on n’oublie pas les barrières de genre.
Deux vélos nous attendent dans la grange. Seuls trois lieux-dits d’une dizaine d’âmes à un kilomètre à la ronde. Mathilda pousse quelques coups de pédales, je la suis. La France rurale, la France des petites et moyennes exploitations agricoles et paysannes défile sous nos yeux. Personne. Les montées de grange sont fermées. Ambiance France 1940 après la débâcle de mai.
Une vieille dame arrache des mauvaises herbes dans un abreuvoir reconverti en pot de fleur. A notre vue, elle se décale de trois pas pour se réfugier dans sa véranda blanche 1er vitrage donnant sur la route. Elle se tient droite, ses mains serrant contre sa poitrine un petit arrosoir d’enfant. Sa tête effectue un balayage de droite à gauche. Nous passons. Savate au pied, elle peut à nouveau arroser ses crocus en toute sécurité.
Par Gauthier Mesnier